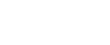Tour de France : vous n’y comprenez rien à la Grande Boucle, voici l'article qu'il vous faut pour en profiter pleinement

Vous avez toujours pensé que le Tour de France était le summum de l’ennui ? C’est mal connaître la Grande Boucle, qui est tout sauf une interminable procession en attendant un sprint de dix secondes.
Non : le Tour de France n’est pas une interminable sieste de trois semaines à travers la campagne française. Soyons francs : les 3 338,8 km de course ne sont pas tous aussi palpitants les uns que les autres. Mais, en trois semaines, il s’en passe des choses sur la route du Tour de France, dont la 112e édition démarre samedi 5 juillet à Lille, avant d’arriver le 27 juillet à Paris.
Souvent réduite à la course au maillot jaune, la Grande Boucle regorge d’une multitude d’enjeux, qui la rendent passionnante si l’on prend le temps de se pencher dessus. Entre les différents types de coureurs, les particularités de chaque étape, et les ambitions distinctes des 23 équipes qui s’entrechoquent, le Tour de France écrit, pendant trois semaines, un roman imprévisible et passionnant. Et qui n’est pas si difficile à suivre, promis !
D'abord, comment ça marche ?
En cyclisme, il y a les bien nommées courses d’un jour, qui se disputent sur une seule journée, comme Paris-Roubaix ou les championnats du monde. Des épreuves sèches, qu’on retrouve chaque année avec chacune ses propres ingrédients, proches d’un blockbuster type James Bond. Mais il y a aussi les courses par étapes, qui s’étalent sur plusieurs jours, avec une étape quotidienne, et plus proches d’une série au long cours comme Game of Thrones. Parmi ces courses à étapes, trois s'étalent sur trois semaines : la Vuelta en Espagne, le Giro en Italie, et le Tour de France, lancé en 1903 et considéré comme la plus grande course cycliste du monde.
/2024/10/29/parcours-carte-tdf-hommes-6720913c4dfc0786893057.png) Le grand départ du Tour de France 2025 sera donné à Lille, le 5 juillet. Trois semaines plus tard, les Champs-Elysées (Paris) accueilleront l'arrivée finale. (ASO)
Le grand départ du Tour de France 2025 sera donné à Lille, le 5 juillet. Trois semaines plus tard, les Champs-Elysées (Paris) accueilleront l'arrivée finale. (ASO)
Concrètement, la Grande Boucle se compose de 21 étapes réparties sur 23 jours, entrecoupées de deux journées de repos - quand même -. Chaque jour, il y a donc un vainqueur d’étape : celui qui franchit la ligne le premier. Jusqu’ici, rien de compliqué. Mais celui-ci n’est pas forcément le maillot jaune. Pour revêtir la précieuse tunique de leader du classement général, il faut être celui qui a parcouru l’ensemble du parcours le plus rapidement. C’est donc le temps cumulé étape après étape qui établit le classement général. Autrement dit : pour enfiler le maillot jaune, rien ne sert de remporter six sprints si c’est pour finir à plusieurs dizaines de minutes des autres sur une étape de montagne.
Car les 21 étapes du Tour de France sont toutes différentes, classables en trois types. D’abord les étapes de plaine qui, comme leur nom l’indique, sont plates et destinées à un sprint massif à l’arrivée. Ensuite les étapes accidentées, qui mêlent plaines et reliefs modérés, pour des coureurs plus polyvalents. Et enfin les étapes de montagne, les plus difficiles, qui sont celles où les prétendants au maillot jaune se jouent la victoire finale. Il faut ajouter à cela les contre-la-montre, où chaque coureur roule seul, sur un parcours plus court.
/2025/07/03/etape18-profil-etape-a-s-o-68667fd1411fb687801395.jpg) Le profil de la 18e étape du Tour de France, entre Vif et Courchevel, prévue le 24 juillet 2025. (ASO - Tour de France 2025)
Le profil de la 18e étape du Tour de France, entre Vif et Courchevel, prévue le 24 juillet 2025. (ASO - Tour de France 2025)
Maillot jaune, à pois, vert... Quelle est la différence ?
Sur le Tour de France, le classement général et les victoires d'étapes ne sont pas les seuls enjeux. C'est pour cela que l'on retrouve quatre maillots distinctifs : le maillot jaune, le maillot à pois, le maillot vert et le maillot blanc. Tous offrent des primes financières et de la visibilité. Le plus connu d’entre eux, le maillot jaune, est porté par le leader au classement général. Suivant le même principe, le maillot blanc est décerné au meilleur coureur de moins de 25 ans au classement général.
Autre tunique iconique de la grande boucle : le maillot à pois. Celui-ci est la propriété du meilleur grimpeur du Tour (ou leader du classement de la montagne). En effet, sur le parcours, plusieurs ascensions sont classées en cinq catégories selon leurs difficultés. Plus une ascension est dure, plus franchir son sommet en tête rapporte des points. Un principe calqué sur celui du maillot vert de meilleur sprinteur. Pour celui-ci, des points sont attribués aux premiers à chaque arrivée. Mais, pour pimenter la course, des sprints intermédiaires sont aussi positionnés en pleine étape. Là aussi, les premiers récoltent des points.
/2025/06/26/000-364l96r-685d1063bce15196889926.jpg) Le podium final du Tour de France 2024 avec le maillot blanc pour Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), le maillot à pois Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates). (THOMAS SAMSON / AFP)
Le podium final du Tour de France 2024 avec le maillot blanc pour Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step), le maillot à pois Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), le maillot vert Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et le maillot jaune Tadej Pogacar (UAE Team-Emirates). (THOMAS SAMSON / AFP)
À noter qu’un même coureur peut dominer plusieurs de ces classements. Mais, les sponsors ayant payé pour de la visibilité - et parce qu’une tunique jaune à pois rouges et manches vertes ne serait pas vraiment esthétique, avouons-le -, il faut que chaque maillot soit porté chaque jour. C’est alors le deuxième de chaque classement qui enfile la tunique. Il n’y a qu’à l’arrivée finale, sur le podium, à Paris, qu’un coureur peut revêtir plusieurs maillots distinctifs, comme Tadej Pogacar en 2020 et 2021.
Si si, c'est un sport collectif
Le cyclisme, un sport individuel ? Bien au contraire. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si les organisateurs ont instauré une récompense pour la meilleure équipe et pour le meilleur équipier en fin de Tour. Car au sein des équipes, composées de huit coureurs, chacun remplit un rôle spécifique. D’abord : le leader, qui vise la plupart du temps la meilleure place possible au classement général. Ses coéquipiers doivent l’aider dans sa quête, chacun à leur façon. Il y a ceux qui impriment le tempo en tête de peloton pour ne pas laisser un concurrent potentiel prendre trop d’avance dans l’échappée, ceux qui protègent le leader du vent en se plaçant devant lui, pour qu’il se fatigue moins, et qu’il puisse être plus frais pour attaquer en fin d’étape.
Sur les étapes de montagnes, un coéquipier peut également être envoyé à l’avant de la course, pour être un futur soutien en fin de journée quand le leader le rattrapera. À l’inverse, en cas de pépin mécanique ou autre, un coéquipier peut se laisser décrocher du peloton pour faire remonter son leader, en le protégeant du vent une nouvelle fois. Au-delà de cette dévotion, les équipiers ont aussi des ambitions propres. En règle générale, chaque équipe compte un sprinteur, qu’il faut lancer idéalement lors des arrivées au sprint en lui offrant la meilleure aspiration possible. Et qu’il faut parfois aider en montagne pour qu’il franchisse la ligne d’arrivée sans être hors délai.
/2025/06/26/000-363w6vf-685d3546cf4a2393316398.jpg) L'équipe Visma-Lease a Bike à l'œuvre pour mener une poursuite derrière une échappée sur la 13e étape du Tour de France 2024. (MARCO BERTORELLO / AFP)
L'équipe Visma-Lease a Bike à l'œuvre pour mener une poursuite derrière une échappée sur la 13e étape du Tour de France 2024. (MARCO BERTORELLO / AFP)
Enfin, il y a les baroudeurs, plus libres et polyvalents, qui peuvent jouer leur chance certains jours dans les échappées, si les directeurs sportifs le permettent. Pour coordonner tout ce petit monde, un des huit coureurs endosse le rôle de capitaine de route. Il s’agit en général d’un coureur expérimenté, relais du directeur sportif pour appliquer la tactique de l’équipe. D’autres sont aussi missionnés pour porter les bidons : c’est à eux d’attendre leur voiture en fin de peloton, de prendre plusieurs bidons, pour les ramener à leurs coéquipiers.
Pourquoi y a-t-il des échappées, même si elles vont rarement au bout ?
Au départ du Tour de France, il y a 184 coureurs. Chaque jour, ils partent ensemble en formant le peloton. Mais, chaque jour, un nombre variable d’entre eux attaque pour prendre de l’avance : c’est ce qu’on appelle une échappée. Le but : arriver sur la ligne en petit groupe, avant le peloton, et donc maximiser ses chances de gagner, tout simplement. Sans doute inspirés par Jean-Claude Dusse, les échappés appliquent le fameux mantra : “Oublie que t’as aucune chance, vas-y fonce ! On sait jamais, sur un malentendu, ça peut marcher”. Car, dans la plupart des cas, les échappés sont repris avant l’arrivée, en raison de l’organisation des équipes de sprinteurs et la voracité de certains grands coureurs qui veulent tout gagner - oui, on parle de vous, monsieur Pogacar -.
:à lire aussiLe Tour de France est-il vraiment un événement "pour les vieux" ?Ce qui n’empêche pas certains de tenter le coup, y compris sur les étapes de plaine, promises aux sprinteurs. Vouées à l’échec, ces échappées sont dites “publicitaires”, car souvent constituées de coureurs d’équipes de seconde zone. Elles permettent de montrer le maillot, et donc les sponsors, pendant plusieurs heures d’antenne, avant que le peloton ne rattrape son retard pour enclencher un sprint massif. Sauf si un malentendu rebat les cartes. C’est finalement sur les étapes avec du relief, un peu mais pas trop, avec quelques petites ascensions bien réparties sur le parcours, que les échappées ont le plus de chances d’aller au bout.
Les baroudeurs, coureurs avec une belle capacité de roulage pour tenir à l’avant en échappée, ou les puncheurs, capables d’attaques sur des ascensions courtes mais très pentues, sont les bons candidats pour passer la journée à l’avant et se jouer la victoire d’étape, sans trop inquiéter les leaders du classement général qui les laissent prendre le large. Car, pour qu’une échappée ait une chance d’aller au bout, il faut que ses membres ne soient pas une menace pour le maillot jaune, auquel cas ce dernier fera rouler son équipe pour rattraper les fuyards.
Classement général, victoire d'étape, maillot à pois... À chaque équipe sa stratégie
Sur le Tour de France, 23 équipes sont au départ. Et toutes n’affichent pas les mêmes ambitions, selon le niveau de chacun de leurs coureurs. D’abord, il y a les armadas construites autour d’un prétendant à la victoire finale comme Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG), Jonas Vingegaard (Visma-Lease a bike), Remco Evenepoel (Soudal-Quick Step) ou Primoz Roglic (Red Bull-Bora Hansgrohe). Pour elles, l’objectif prioritaire est de mettre le leader dans les meilleures dispositions pour la lutte pour le maillot jaune.
L’autre stratégie principale, ce sont les équipes qui comptent sur un sprinteur pour remporter des victoires d’étapes. Ces dernières sont les grandes ennemies des échappées, et sont organisées autour d’une flèche comme Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), Jonathan Milan (Lidl-Trek) ou Tim Merlier (Soudal-Quick Step). Enfin, les équipes qui n’ont ni de grand leader, ni de grand sprinteur, chassent les victoires d’étapes, notamment en se plaçant dans les échappées.
Mais avec 21 étapes pour 23 équipes, il ne peut y en avoir pour tout le monde. Certains coureurs vont ainsi se concentrer sur la lutte pour le maillot à pois, ou pour celle pour le maillot vert. Tout en sachant que les plus grosses formations sont parfois armées pour mêler toutes ces stratégies à la fois. Sans oublier que cinq des vingt-trois équipes sur le Tour sont invitées par l'organisation. Ces dernières cherchent donc à se montrer le plus possible et à animer la course, pour justifier leur invitation.
Et même en sachant tout cela, c'est un feuilleton plein de surprises
Si vous avez lu jusqu’ici, vous maîtrisez les bases pour passer votre mois de juillet dans le canapé. Mais dites-vous bien qu’il ne s’agit que d’un aperçu théorique du feuilleton Tour de France. Car, comme tout feuilleton, il est ensuite sublimé - ou pas - par ses principaux acteurs et leurs sauts d’humeur. Autrement dit, chaque coureur, avec sa personnalité, ses coups de gueule, ses erreurs, ses coups de sang, peut faire basculer la Grande Boucle dans une autre dimension.
Sans oublier les aléas climatiques. Quand un consultant hurle qu’il pleut sur la route du Tour, ce n’est pas parce qu’il est trempé, mais parce que l’eau précipite les chutes. Le froid peut aussi assommer certains coureurs, de façon soudaine, tout comme le soleil. S’il souffle de côté sur une portion peu abritée, le vent peut aussi briser le peloton en plusieurs groupes (ce qu’on appelle une bordure). Une moto en panne ou une voiture qui cale peuvent aussi briser la monotonie d’une étape.
/2025/07/02/000-d8502-6865a14111280046707995.jpg) Christopher Froome à pieds dans le Mont Ventoux, après une chute, le 14 juillet 2016. (JEFF PACHOUD / AFP)
Christopher Froome à pieds dans le Mont Ventoux, après une chute, le 14 juillet 2016. (JEFF PACHOUD / AFP)
Tout cela ne constitue qu’un aperçu des imprévus qui font du Tour de France un roman passionnant. Qui pouvait prévoir que Christopher Froome, maillot jaune sur le dos, grimperait une partie du Mont Ventoux à pied en 2016 ? Qu’une spectatrice allemande créerait une chute massive en 2021 avec une pancarte dédiée à ses grands-parents ? Et puis, même quand tout se passe comme prévu, la Grande boucle reste un voyage de trois semaines à travers la France et son patrimoine, de quoi séduire tous les publics.
Source de l'article : France Info Sport "Juillet 2025"
France Télévisions - Rédaction Sport